En Inde, les populations vulnérables ont besoin d'une aide d’urgence pour faire face à la pandémie de COVID-19

En Inde, le nombre de contaminations est encore bas par rapport à celui que connaissent de nombreux autres pays et je pense que cela est dû en grande partie aux premières mesures prises pour contrôler l’entrée des personnes dans le pays, pour effectuer des tests en grand nombre et pour rechercher les cas contacts - c'est-à-dire pour déterminer qui a pu être en contact avec des personnes infectées. Cela, je pense, est également dû aux mesures de distanciation sociale et à un certain nombre d'autres mesures.
Le pays se prépare à affronter cette maladie sur le front sanitaire : on dispense de très nombreuses formations, on développe l'infrastructure, on prépare les lits d'hôpitaux et les équipements et on fait le nécessaire pour acheminer ces derniers là où ils sont nécessaires, quand c’est nécessaire. Cependant, nous n'en sommes encore qu'au début et nous devons attendre de voir comment les choses vont évoluer.
Des citoyens vulnérables face à une crise humanitaire
Le lutte contre cette maladie comporte deux volets. Le premier est sanitaire ; et il nous préoccupe au plus haut point dans le monde entier. Ici, en Inde, les investissements dans la santé, qui représentent environ 1 % à 1,3 % du PIB, sont très limités et nous sommes préoccupés par les conséquences de cette situation, car ces investissements ne seraient pas suffisants pour permettre au pays de répondre à la maladie, si celle-ci devait prendre l’ampleur qu’elle a eue dans d'autres pays.
L'autre volet est lié à l'impact socio-économique du confinement. Il est regrettable que l’ensemble de la population n'ait pas été prévenue suffisamment à l'avance de la mise en place de cette mesure. C’est notamment regrettable pour les personnes les plus vulnérables qui travaillent dans le secteur informel, lequel représente une part considérable de l'économie en Inde.
Ces travailleuses et travailleurs n'ont pas eu le temps de s'organiser, ni de négocier la manière dont ils pourraient rester, si bien que nombre d'entre eux ont pris l'initiative de partir. Or, à ce moment-là, les transports publics avaient été interrompus à cause du confinement et ces personnes se sont donc retrouvées dans une situation extrêmement difficile et elles continuent, à l'heure actuelle, à faire face à d'énormes difficultés.
Le gouvernement indien vient de débloquer une enveloppe de 24 milliards de dollars pour tenter d'alléger un peu leur souffrance. Tout cet argent n'est pas destiné aux travailleurs migrants, mais une grande partie l'est. Le gouvernement a également qualifié la pandémie de COVID-19 de catastrophe nationale, ce qui signifie qu'au niveau des États, il a débloqué l'équivalent d'un milliard de dollars, en partie pour aider les migrants et les sans-abris. On constate, en outre, qu’il y a un fantastique élan de solidarité dans la société civile.
Bien que 24 milliards de dollars puissent sembler être une somme importante, je crains que cette enveloppe ne soit pas suffisante. Elle ne l’est certainement pas si l'on considère la situation à laquelle sont confrontés les groupes les plus marginalisés de la société et elle ne sera certainement pas suffisante si l'on tient compte de l'impact économique plus large de cette crise.
Les ONG et la société civile, ainsi que celles et ceux qui travaillent pour les programmes gouvernementaux, devront aller plus loin que par le passé pour essayer d'aider les personnes vulnérables et marginalisées à faire face à cette situation extraordinaire.
S'attaquer au problème de la stigmatisation
La COVID-19 est une calamité qui fait ressortir le meilleur et le pire de la société. On peut le constater dans le monde entier. Ici, en Inde, le grand défi consiste à réduire le facteur peur et à faire comprendre aux gens que ce n'est pas parce qu’une personne a la maladie qu’elle est nuisible.

Photo : © UNICEF/Altaf Ahmad
Il faut comprendre que si une personne contracte la maladie, ce n'est pas sa faute et elle ne doit pas être blâmée pour cela. Le problème de la stigmatisation découle de la peur, des préjugés, de la division, parfois du racisme et de ce qu’il y a de pire dans la nature humaine. Nous devons tout faire pour réduire la stigmatisation au minimum, voire l'éradiquer complètement.
Les vidéos que nous avons vues de travailleurs migrants se faisant asperger de produits désinfectants sont absolument intolérables. Elles témoignent d'une réaction irrationnelle et indigne. Mais nous avons également vu d'autres formes de stigmatisation. Les personnels de santé qui travaillent en première ligne, ceux-là mêmes qui contribuent à sauver ce pays d'un impact bien plus important de la maladie, sont stigmatisés, et cela est très préoccupant.
Nous sommes tous dans le même bateau. Cette maladie ne fait pas de distinction entre les riches et les pauvres, entre la peau blanche et la peau noire. La seule façon de nous en sortir est de nous unir et de faire preuve de solidarité et de compassion les uns envers les autres.
Le rôle de l'ONU dans la lutte contre la pandémie en Inde
Depuis plus de huit semaines, l’ONU travaille en étroite collaboration avec le gouvernement, tant au niveau central qu'au niveau des États. Nous fournissons un appui technique, nous intervenons rapidement en apportant des clarifications sur les questions liées à la COVID-19 et en répondant aux questions sur la manière dont les autres pays procèdent.

Nous achetons des fournitures essentielles pour les autorités, nous les aidons à dispenser des formations, tant au niveau central qu'au niveau des États et nous menons beaucoup d'autres actions dans le domaine de la santé.
S’agissant de la gestion de l'impact socio-économique, nous travaillons sur la nutrition, l’approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène et nous traitons la question de l'impact de ce virus sur les femmes : avec autant de jours de confinement décrétés, nous sommes préoccupés par la hausse significative du nombre de cas de violence de genre.
Quant aux questions relatives aux personnes employées dans le secteur informel, elles figurent elles aussi en tête de liste : comment ces personnes pourront-elles s'en sortir pendant cette période et comment se remettront-elles sur pied une fois la phase de relance amorcée ?
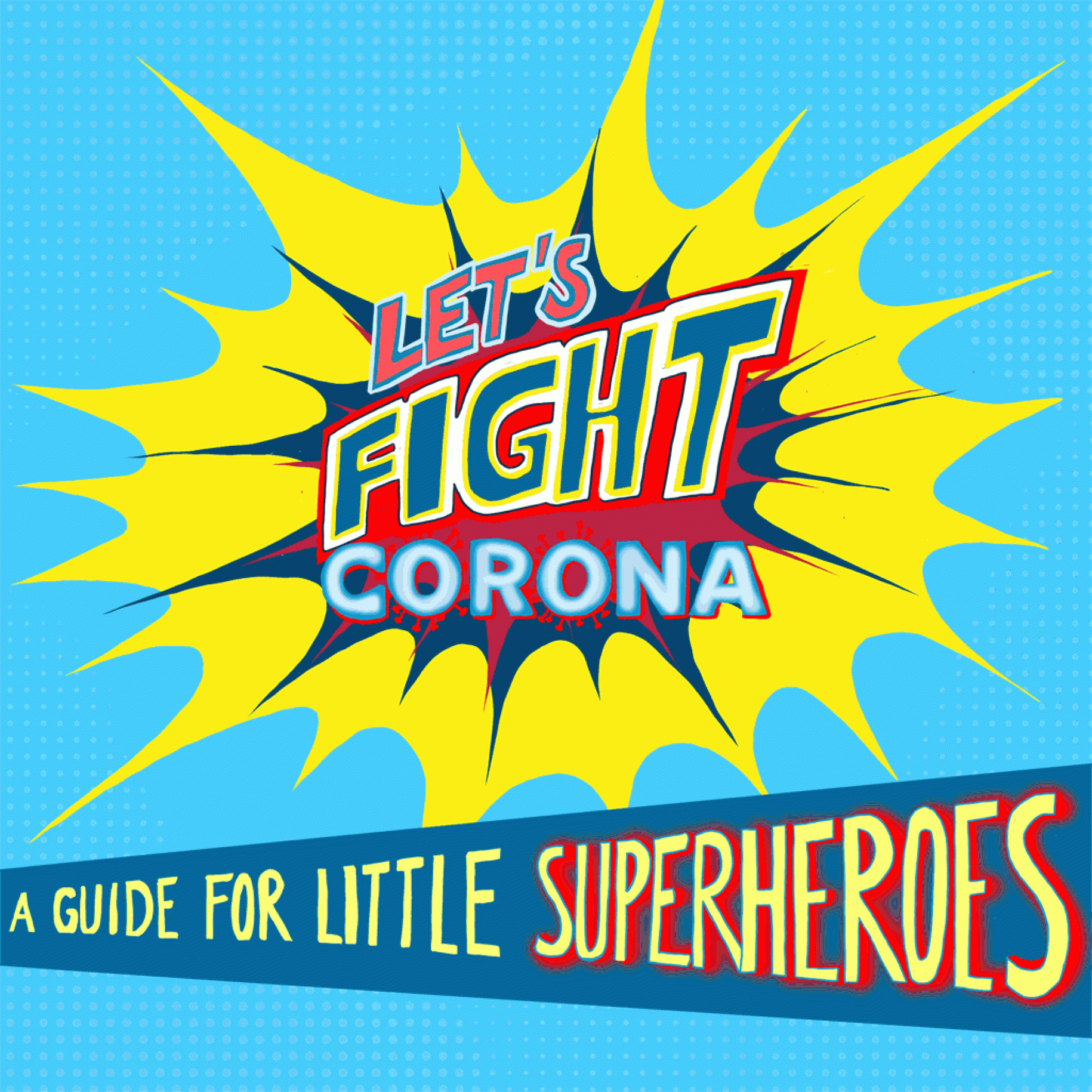
Les défis à venir
Nous savons que ce virus va toucher probablement différentes parties du pays à des moments différents. Compte tenu de la taille de l'Inde, il mettra un certain temps à s’y propager. L'un des défis qui nous attendent consistera donc à s'assurer que tout le monde respecte les mesures d’assainissement, les mesures sanitaires et toutes les autres mesures préventives pendant une longue période, ce qui risque d'être difficile.
En termes de trajectoire du virus, dans les pays plus avancés que l'Inde, il y a eu un impact sévère sur les revenus et le bien-être socio-économique des gens : nous n'avons jamais connu de situation où, soudainement, toute l'économie mondiale s'est retrouvée pratiquement à l’arrêt.
Le gouvernement indien va devoir mettre en œuvre un vaste programme d’aide pour garantir le paiement des salaires, aider certaines entreprises à se remettre sur pied et maintenir le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement pour répondre aux besoins de ces entreprises.
Ces questions concernent tous les gouvernements. De nombreuses projections ont été réalisées pour prévoir l'impact socio-économique de cette pandémie, mais le virus n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière et nous ne savons pas quelle sera sa trajectoire.
Beaucoup d’interventions sont mises en œuvre pour freiner l'assaut de la COVID-19 sur l’Inde, mais personne ne peut dire avec certitude comment nous devons avancer. Nous ne savons pas quel sera l'impact final de cette crise : tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il sera considérable.
Renata Dessallien, la Coordonnatrice résidente des Nations Unies en Inde, évalue la situation actuelle. Son blog est basé sur une interview réalisée par ONU Info. Pour consulter l'article tel qu’il a été publié à l’origine, en anglais, sur le site d’ONU Info, cliquez ici. Blog traduit en français par le Bureau de la coordination des activités de développement (BCAD).







































