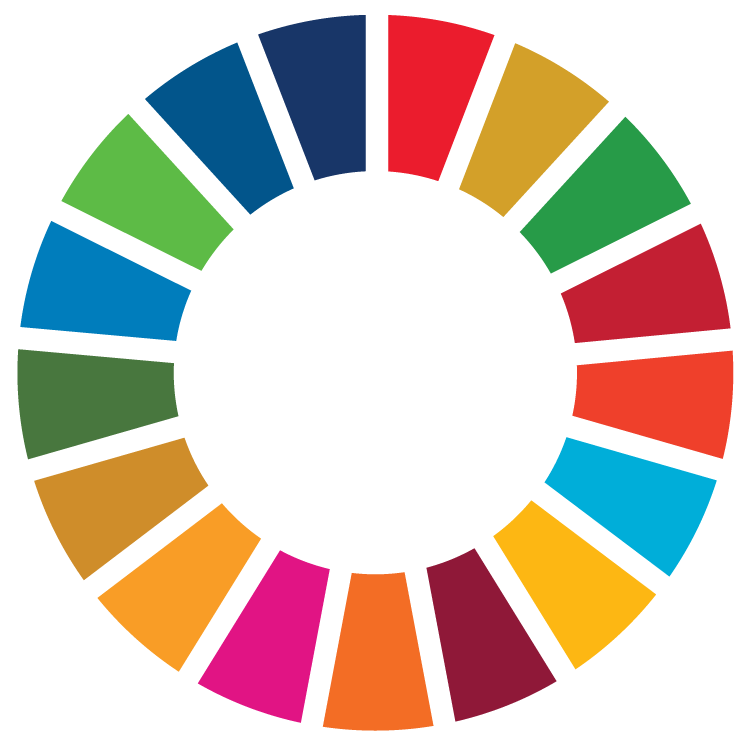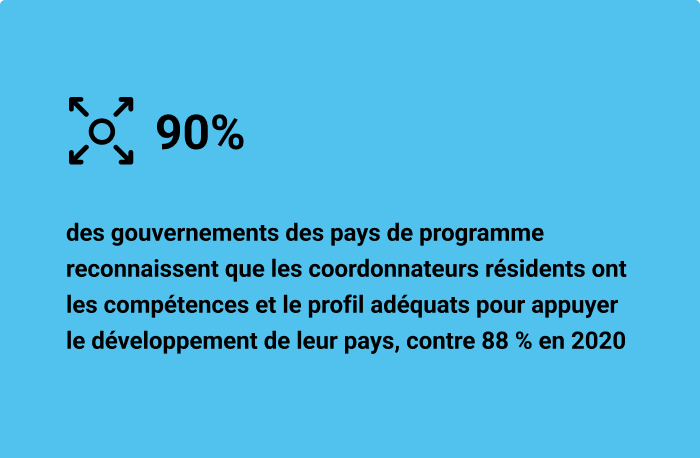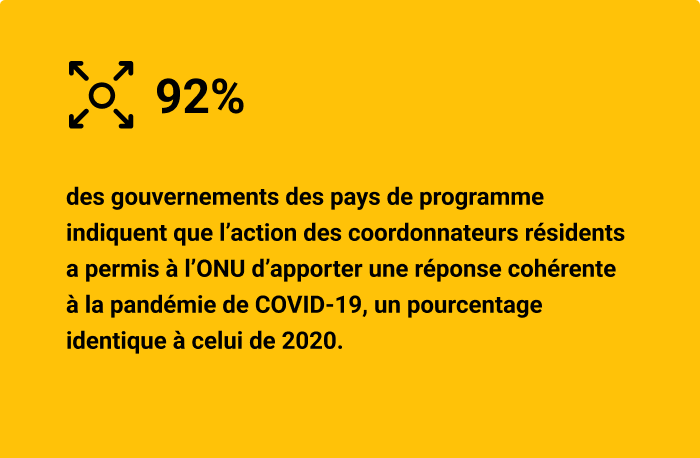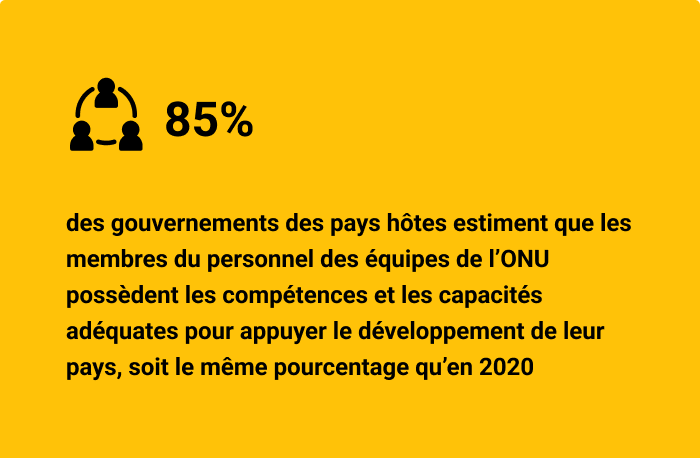Rapport 2022 de la Présidente du GNUDD sur le Bureau de la coordination des activités des développement
Résumé analytique
Résumé analytique
Il y a quatre ans, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a réorganisé ses activités d’appui aux pays en vue d’accélérer la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Cette réorganisation a permis de renforcer la coordination des activités de développement sur le terrain et de tirer ainsi le meilleur parti des interventions mises en œuvre par l’ONU pour l’intérêt de tous les peuples et de la planète. Les retours sur investissements de cette réforme se sont traduits par des résultats concrets en dépit d’une nouvelle année difficile pendant laquelle les pays en développement ont continué à faire face aux impacts de la pandémie dans un contexte d’instabilité mondiale accrue. Ces résultats ont été rendus possibles grâce à la fourniture d’un soutien rapide, cohérent et efficace aux pays.
Aujourd'hui :
130 coordonnatrices et coordonnateurs résidents ("coordonnateurs résidents" dans la suite de ce rapport) pilotent l’action menée par les équipes de l'ONU présentes dans 162 pays et territoires pour aider à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030). Ce travail d’encadrement consiste notamment à coordonner les interventions sanitaires, humanitaires et socio-économiques de l’ONU en réponse à la crise de la COVID-19 et à résoudre des problèmes complexes, interdépendants et transfrontaliers qui vont de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation de ses effets à la transformation des systèmes alimentaires, en passant par la prise en compte des besoins des femmes et des filles dans l’optique de bâtir des sociétés plus équitables dans lesquelles personne n’est laissé pour compte.
des gouvernements des pays de programme indiquent que, depuis le repositionnement du système des Nations Unies pour le développement en 2018, les entités du système travaillent mieux ensemble. Cette proportion représente une hausse de 4 % par rapport à 2020.
des gouvernements des pays de programme estiment que les coordonnateurs résidents pilotent efficacement l'action menée par les équipes de l’ONU à l’appui de la mise en œuvre des priorités nationales. Cette proportion était de 88 % en 2020 et de 79 % en 2019.
Opinion des gouvernements : Les coordonnateurs résidents dirigent efficacement le travail des équipes de l’ONU sur le terrain
des gouvernements des pays de programme reconnaissent que les coordonnateurs résidents ont les compétences et le profil adéquats pour appuyer le développement de leur pays, contre 88 % en 2020.
Opinion des gouvernements : Le coordonnateur résident a les compétences et le profil adéquats pour appuyer le développement du pays
des pays donateurs indiquent que le système des coordonnateurs résidents a permis d’améliorer la cohérence des activités de l'ONU et de réduire ainsi les doubles emplois.
des pays donateurs déclarent que le système des coordonnateurs résidents a permis de mettre en place plus d’interventions conjointes à l’appui de la réalisation des ODD
des pays donateurs considèrent que le système des coordonnateurs résidents a permis d’exploiter les avantages comparatifs des différentes entités composant le système.
des pays donateurs déclarent que, depuis le repositionnement du système des Nations Unies pour le développement, les entités des Nations Unies travaillent de manière plus concertée.
Pendant toute la durée de la pandémie de COVID-19, les coordonnateurs résidents ont continué à constituer une première ligne de défense, guidant l'action collective du système des Nations Unies pour le développement et mobilisant des équipes réduites pour mettre en place, à l'échelle du système, une réponse à la crise qui a permis de protéger, de soutenir et de servir les gouvernements nationaux, leurs populations et tous les partenaires concernés.
Opinion des gouvernements : L’action du coordonnateur résident a permis à l’ONU d’apporter une réponse cohérente à la pandémie de COVID-19
des gouvernements des pays de programme indiquent que l’action des coordonnateurs résidents a permis à l’ONU d’apporter une réponse cohérente à la pandémie de COVID-19, un pourcentage identique à celui de 2020.
Les interventions mises en œuvre par l'ONU dans les pays où elle opère sont désormais mieux intégrées et plus efficaces. La nouvelle génération d'Analyses communes de pays et de Plans-cadres de coopération pousse les équipes de de l’ONU à renforcer les activités conjointes de planification et de programmation sous la direction des coordonnateurs résidents. Ces outils vont au-delà des approches sectorielles et s'appuient davantage sur les compétences disponibles au sein des différentes entités du système pour aider les pays à relever les défis complexes et interconnectés que pose la mise en œuvre des ODD.
À la fin de l’année 2021, 52 % des équipes de l’ONU avaient remplacé leur Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement (PNUAD) par un Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable (Plan-cadre de coopération).
À la fin de l’année 2021, tous les Plans de réponse socio-économique à la COVID-19 avaient été intégrés aux Plans-cadres de coopération/PNUAD.
Opinion des gouvernements : Les membres du personnel de l’ONU possèdent les capacités et les compétences adéquates
des gouvernements des pays hôtes estiment que les membres du personnel des équipes de l’ONU possèdent les compétences et les capacités adéquates pour appuyer le développement de leur pays, soit le même pourcentage qu’en 2020.
Le système des coordonnateurs résidents a contribué, à tous les niveaux, à susciter l’intérêt et la mobilisation pour les sommets mondiaux qui se sont tenus en 2021 sur les priorités clés en matière d’ODD, comme la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de Glasgow (COP26) et le Sommet sur les systèmes alimentaires qui s’est déroulé à New York.
Les coordonnateurs résidents ont veillé à ce que le développement durable reste un objectif central de leur action, même en temps de crise.
Ils ont renforcé les synergies entre les interventions mises en place en matière de développement, d'aide humanitaire et de consolidation de la paix, comme au Sahel, et ont piloté avec célérité la mise en place d’interventions en réponse aux crises, comme dans les Tonga et à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, grâce notamment, dans ces deux cas particuliers, aux moyens de coordination supplémentaires mis à disposition par les bureaux multipays.
Le système des coordonnateurs résidents a renforcé sa capacité à promouvoir l’établissement de partenariats avec l’ensemble des parties prenantes en vue d’une mise en œuvre plus efficace du Programme 2030. Il a notamment favorisé la mise en place de collaborations renforcées avec les institutions financières internationales, les acteurs du secteur privé et les partenaires du monde universitaire.
Le rôle des coordonnateurs résidents, qui se sont appuyés sur l’expertise des économistes travaillant au sein de leurs bureaux, s’est avéré essentiel pour faire évoluer le discours de l’ONU en matière de financement et faire en sorte qu’il mette l’accent sur la notion de financement "structuré" en lieu et place de la notion de financement dite "fragmentaire". Les coordonnateurs résidents ont joué un rôle clé s’agissant de l’amélioration de la qualité des mécanismes de financement du système des Nations Unies pour le développement.
- Les coordonnateurs résidents en poste dans les petits États insulaires en développement (PEID) ont piloté le processus d'élaboration d'un Indice de vulnérabilité multidimensionnel pour ces pays, en collaboration avec les entités concernées de l’ONU telles que le Département des affaires économiques et sociales, le Bureau du Haut Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement et le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi qu’avec des partenaires externes. L’Indice de vulnérabilité multidimensionnel peut changer la donne pour l’ensemble des PEID en leur permettant d’accéder à des financements à des conditions favorables et de restructurer leur dette.
- Le renforcement de la coordination des activités a permis d’améliorer de manière considérable l'accès des équipes de l’ONU aux mécanismes mondiaux de financement commun. La proportion des équipes de l’ONU ayant eu accès à ces mécanismes est en effet passée de 47 % en 2020 à 85% en 2021.
Le système des coordonnateurs résidents a renforcé son engagement en faveur d'une transparence et d'une obligation redditionnelle totales.
- En 2021, 99 % des équipes de l’ONU ont présenté leur rapport annuel sur les résultats au gouvernement national du pays où elles opèrent.
- Le dispositif de communication des résultats destiné à rendre compte à l’échelle du système de l’appui collectif apporté à la mise en œuvre des ODD a été perfectionné.
- Un nouveau Cadre de résultats pour le système des coordonnateurs résidents a été présenté au Conseil économique et social des Nations Unies.
- Le travail d’amélioration du système de données UN-INFO s'est poursuivi. Le système UN INFO est la seule plateforme qui permet, d’une part, de suivre les activités, les financements et les partenariats mis en place à l'échelle du système pour appuyer la mise en œuvre des ODD et, d’autre part, de donner à l’ensemble de ces informations toute la visibilité nécessaire.
- Un nouveau Portail de données relatives à l’action face à la COVID-19 a été mis en place pour le Groupe des Nations Unies pour le développement durable. Il met en avant les données recueillies sur le travail des équipes de l’ONU et permet de visualiser les données extraites du système UN-INFO et d'autres séries de données téléchargeables.
- Le site web du Groupe des Nations Unies pour le développement durable est disponible dans toutes les langues officielles de l'ONU.
- En 2021, le Bureau de la coordination des activités de développement (BCAD) a lancé un nouveau site web.
- Les 132 équipes de l’ONU disposent désormais chacune de son site web. Au total, les 132 sites web couvrent plus de 22 langues.
Après avoir dépendu des services fournis par des prestataires externes, les sites web des équipes de l’ONU bénéficient désormais de l’appui du BCAD, ce qui permet aux équipes d'économiser environ 2 millions de dollars par an.
Le système des coordonnateurs résidents a continué à mettre en œuvre la réforme du système des Nations Unies pour le développement, notamment :
- en fournissant un appui pour l’élaboration d’une nouvelle architecture régionale.
- en étant le fer de lance du processus de mise en œuvre du Pacte de financement.
- en faisant avancer le programme d'amélioration de l’efficacité.
En 2021, une Stratégie relative aux activités opérationnelles était en place dans chacune des 132 équipes de l’ONU. L’objectif visé a ainsi été atteint avant la date limite du 31 décembre qui avait été fixée par le Secrétaire général.
Le succès de l’action menée par le système des coordonnateurs résidents a été validé par un examen effectué par l'Assemblée générale portant sur le fonctionnement et les mécanismes de financement du système des coordonnateurs résidents. Ce succès a également été attesté par une évaluation réalisée par le Bureau des services de contrôle interne (BSCI) des Nations Unies et par des examens externes tels que celui effectué par le Réseau d’évaluation de la performance des organisations multilatérales (MOPAN).
Des inquiétudes subsistent toutefois, car le montant des fonds mobilisés pour financer le système des coordonnateurs résidents demeure en-deçà du niveau requis pour répondre aux besoins. En 2021 :
- 215 millions d'USD seulement ont été mobilisés, une somme bien inférieure au montant budgété de 281 millions d'USD.
- Seul un nouvel État membre a réalisé sa toute première contribution financière et plusieurs États membres ayant contribué financièrement en 2019 ou en 2020 n’ont pas réitéré l’opération.
- Au total, 28 États membres ont fourni un apport financer volontaire au système des coordonnateurs résidents. Il s’agit du chiffre le plus bas enregistré depuis la création du système des coordonnateurs résidents.
Le manque de stabilité financière met en péril la réalisation de nouvelles avancées par le système des coordonnateurs résidents.
Le déficit de capitalisation du Fonds d’affectation spéciale observé au cours des trois dernières années a été compensé jusqu'à présent par une gestion financière prudente, des choix rigoureux en matière de recrutement et la réaffectation des économies réalisées en raison de la réduction des activités dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et notamment en raison des restrictions mises en place sur les déplacements.
Le comblement de ce déficit de financement sera une priorité absolue pour l’année 2022, car il permettra au système des coordonnateurs résidents de fonctionner de manière optimale.
Le système ayant atteint sa pleine capacité, la marge de manœuvre dont il dispose pour échelonner les dépenses comme il a pu le faire jusqu'ici est aujourd’hui considérablement réduite, notamment avec le retour à la normale des activités mises en œuvre sur le terrain dans un contexte post-pandémique.